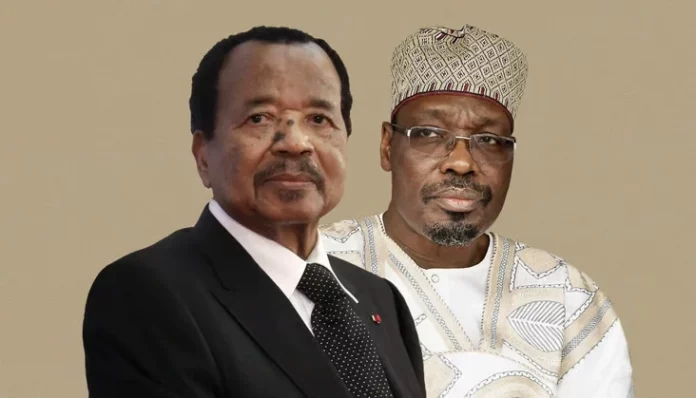Le roi Charles III a prié jeudi avec le pape Léon XIV. C’est une première depuis le schisme anglican de 1534. La célébration s’est tenue dans la chapelle Sixtine. Elle mêlait rites catholiques et anglicans. Ce geste marque un tournant. L’Église d’Angleterre et Rome renouent publiquement. Le roi, chef suprême de l’Église anglicane, franchit une ligne historique. Ainsi, l’écart de cinq siècles se resserre.
La cérémonie a mêlé des rites catholiques et anglicans. Elle marque un rapprochement inédit entre les deux Églises. Depuis 1534, date du schisme provoqué par Henri VIII, aucun geste n’avait atteint cette portée. Ce jeudi, l’écart s’est resserré. L’histoire religieuse britannique entre dans une nouvelle phase.
Sous les fresques de Michel-Ange, Léon XIV et Stephen Cottrell ont dirigé la célébration. Des prélats catholiques et anglicans étaient présents. Des responsables politiques et diplomates ont assisté. La chorale de la chapelle Sixtine a chanté avec celle de Saint-Georges de Windsor. L’union liturgique était visible. Le symbole, puissant.
Moment clé de la visite d’État, la prière a duré trente minutes. Elle portait sur la protection de la nature. Dix ans après Laudato Si’, les deux Églises affichent leur convergence écologique. Le geste est clair : Rome et l’Angleterre parlent d’une même voix sur l’environnement.
Peu avant la prière, Charles III a rencontré le pape en privé. C’était leur première entrevue. Le souverain pontife, un Américain, a succédé à François en mai. Le roi, gouverneur suprême de l’Église anglicane, a échangé avec lui dans un cadre cordial.
Charles III a rencontré le pape dans une ambiance cordiale. Il était accompagné de Camilla, voilée d’une mantille noire. Le roi s’est exprimé en anglais. Les deux chefs d’État ont échangé des cadeaux. Le Vatican a diffusé les images.
– Différends théologiques –
La visite du roi survient dans un contexte sensible. Son frère Andrew est de nouveau mis en cause dans l’affaire Epstein. Des révélations accablantes ont émergé. La monarchie est fragilisée. Le roi agit sous pression.
L’anglicanisme est né d’un schisme. Henri VIII voulait annuler son mariage avec Catherine d’Aragon. Le pape a refusé. En 1534, le roi a rompu avec Rome. Il a fondé l’Église d’Angleterre et s’en est proclamé chef.
Pour William Gibson, historien à Oxford Brookes, cette prière est historique. Il souligne une contrainte légale : le roi d’Angleterre doit être protestant. Ce geste, inédit, franchit une ligne symbolique. Il marque un tournant dans les relations entre Rome et Londres.
« De 1536 à 1914, il n’y avait pas de relations diplomatiques officielles entre le Royaume-Uni et le Saint-Siège », dit-il. Londres n’a ouvert une ambassade au Vatican qu’en 1982.
Depuis 2013, les membres de la famille royale peuvent épouser des catholiques sans perdre leur place dans l’ordre de succession. Avant cette réforme, ils étaient exclus. William Gibson insiste : ce changement est récent. Il souligne la lente évolution des règles monarchiques.
Ce rapprochement est récent. Il est important, souligne le frère Hyacinthe Destivelle. L’anglicanisme est né en opposition à Rome. Cette prière commune marque une rupture avec cinq siècles de distance. Le geste est fort.
L’Église anglicane autorise l’ordination des femmes et le mariage des prêtres. Elle vient de nommer Sarah Mullally à sa tête. C’est une première. Âgée de 63 ans, mère de famille, elle succède à Justin Welby. Sa nomination provoque des tensions internes.
Sarah Mullally prendra ses fonctions en janvier 2026. Elle n’était pas présente jeudi. Son absence souligne la transition encore en cours. L’Église anglicane entre dans une nouvelle ère.
– « Confrère royal » –
Jeudi après-midi, Charles et Camilla ont assisté à un service œcuménique. Il s’est tenu à Saint-Paul-hors-les-murs, l’une des quatre basiliques majeures de Rome. Le geste confirme leur volonté de dialogue interconfessionnel.
Le roi Charles III a reçu le titre de « confrère royal ». Un siège spécial a été créé pour lui dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. Il y restera. Ses successeurs pourront l’utiliser. Le geste est symbolique. Il inscrit la monarchie britannique dans un espace liturgique romain.
Le 9 avril, Charles III et Camilla ont rencontré le pape François en privé. Douze jours plus tard, le pontife est décédé. Le roi a été représenté par William aux funérailles, puis par Edward à la messe d’intronisation de Léon XIV, le 18 mai. La transition papale s’est faite sous le regard de la monarchie britannique.
En 1961, Elizabeth II s’est rendue au Vatican. C’était une première depuis le schisme de 1534. Aucun monarque britannique ne l’avait fait avant elle. Le geste était fort, mais sans prière commune. Charles III va plus loin.
Sous les voûtes de ses cathédrales, l’Église d’Angleterre résonne moins fort. Si elle revendique près de vingt millions de fidèles baptisés, ses bancs se vident : en 2022, moins d’un million de pratiquants réguliers franchissent ses portes chaque semaine.
Ce contraste entre appartenance nominale et engagement actif révèle une érosion silencieuse. L’institution, jadis pilier spirituel et politique du royaume, peine à mobiliser. Le rite subsiste, mais la ferveur s’efface. Et dans ce recul, une question : que reste-t-il du lien sacré entre la Couronne, le peuple et l’autel ?
Source: Agence France-Presse